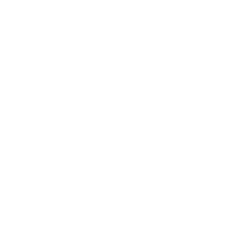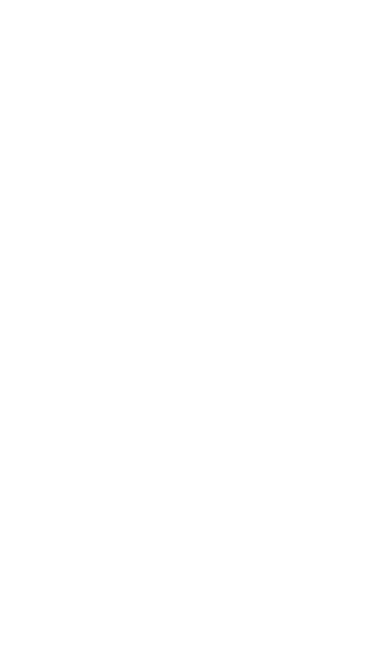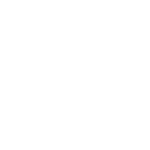L’art de Rosenjin, Génie de la cuisine japonaise
04/07/2013. Visite conférence de l’exposition « L’art de Rosenjin, Génie de la cuisine japonaise » au Musée Guimet, commentée par Mme Christine Shimizu, Directrice du Musée Cernuschi, Conservateur en chef du Patrimoine.
Kitaôji Rosanjin (1883-1959) fut un personnage hors du commun dont les premières années de la vie ressemble à un roman de Dickens. Fils d’une employée d’un sanctuaire shinto de Kyôto et d’un jeune homme en charge des crémations (qui se suicida peu après sa naissance), il fut abandonné par sa mère qui le confia à la femme d’un policier. Ce dernier s’étant suicidé, il sera recueilli par la belle famille de sa mère adoptive où il n’est pas particulièrement bien accueilli. Un voisin graveur, pris de compassion pour l’enfant, l’adopte à nouveau et lui apprend vers dix ans les rudiments de son métier. Très impressionné par une enseigne gravée par le grand peintre de Kyôto, Takeuchi Seihô, Rosanjin s’intéresse au travail de celui-ci et découvre la calligraphie à laquelle il se forme en autodidacte. Il n’est pas admis à l’Ecole d’art municipale de Kyôto, mais remporte lors d’un concours les trois premiers prix de calligraphie qui lui permettent de réunir un peu d’argent.
Muni de ce petit pécule, il part à Tôkyô pour retrouver sa mère qu’il a perdu de vue. Avec celle-ci, il s’installe en Corée de 1908 à 1910 et se marie. De retour au Japon, il travaille chez un imprimeur où un mécène l’introduit auprès d’artistes de Kanazawa, en particulier des céramistes. C’est dans cette ville qu’il découvre la technique des émaux sur couverte. Sa passion pour ce matériau le pousse à réunir une collection de porcelaines chinoises qu’il présente dans une galerie qu’il ouvre à Tôkyô. Au premier étage de cette galerie, il crée un restaurant où il sert à ses clients des plats qu’il prépare. Cet endroit qu’il appelle « le Club des Gourmets » (Bishoku club) devient vite un endroit à la mode. Suite à ce succès, il ouvre en 1925 « le Salon de la Colline aux Etoiles » ((Hoshigaoka-saryô) où il dirige les cuisiniers. Mécontent des récipients qu’il trouve pour servir cette cuisine, il décide de réaliser lui-même ou de diriger des céramistes qui mettront le mieux en valeur les mets. C’est sur un beau terrain de Kita Kamakura qu’il fait édifier trois maisons, des édifices anciens déplacés de la campagne japonaise. Autour, il construit des fours et fait appel aux plus grands potiers de l’époque, comme Arakawa Toyozô (1894-1985), spécialiste de la céramique de Mino et Kaneshige Tôyô (1896-1967), spécialiste de la céramique de Bizen, qui l’aide pour le choix des argiles et la construction des fours.
Cependant, Rosanjin a un caractère irascible et n’hésite pas à chasser des clients qu’il ne considère pas dignes de sa cuisine. Le restaurant décline et finira par fermer. Durant la seconde guerre mondiale, il doit renoncer à la production de céramiques (les feux étant interdits pour éviter les bombardements américains) et il produit des laques. Il ne reprendra la céramique qu’après la guerre, mais la conjoncture économique est difficile. Ayant dû vendre ses maisons de Kita Kamakura, il ouvre une petite boutique à Tôkyô dans le quartier de Ginza où il vend sa production aux occupants américains. En 1952, il fait la connaissance du designer et céramiste américain d’origine japonaise, Isamu Noguchi (1904-1988). Celui-ci l’aide à organiser une exposition aux Etats-Unis où il se rend en 1954 pour présenter ses oeuvres au MoMA de New-York. Parti avec 500 céramiques, il finira par donner celles-ci à des amis américains. Au cours de ce voyage, il passe par la France où il demande à rencontrer Picasso, mais les deux fortes personnalités ne pourront pas s’entendre. De retour au Japon, il prend l’habitude de se rendre dans des restaurants où il apporte lui-même les ingrédients qu’il a choisi et se fait servir dans sa vaisselle. Sa céramique fait toujours référence aux céramiques traditionnelles, tout en leur apportant une touche personnelle.
Le Japon est le pays de la cuisine : le nombre de restaurants y est impressionnant. Chaque ville ou village a ses spécialités et les voyageurs ne manquent pas d’en rapporter quelques exemples pour leurs proches. Les guides touristiques japonais font toujours état des meilleurs restaurants, cafés ou pâtisseries et ceci sans aucune mesure avec nos guides français. De nombreuses revues hebdomadaires ou mensuelles sont consacrées aux restaurants et à la nourriture. Cette passion pour les plats est telle qu’il n’est pas de film japonais sans scène de banquet !
La cuisine japonaise n’est pas une cuisine au sens occidental du terme (nécessitant cuisson, sauce, plat mijoté) : elle préserve avant tout le goût naturel des ingrédients. Outre leur saveur, leur couleur, leur parfum, leur présentation et également les allusions littéraires auxquels ils se réfèrent sont des critères décisifs de la qualité du repas.
Le repas japonais se déroule assis par terre devant une petite table-plateau (ozen). Cette coutume est déjà présente au VIIIe siècle : à la cour impériale, les plateaux sont en bois laqué, tandis que le peuple mange sur une simple planche de bois. A partir du XIVe siècle est mis en place pour la classe militaire un service de table inspiré de celui de la cour désigné sous le nom de honzen ryôri ou « repas à plateau principal ». Utilisé jusqu’au XXI è siècle, ce style formel est surtout présent dans les repas de mariage et de cérémonies. Il se compose d’une table-plateau principal (honzen) avec des bols de soupe et de riz, des condiments et des plats d’accompagnement, et des tables-plateaux annexes (souvent 2 ) comportant également des plats grillés, bouillis ou crus. Le nombre (en japonais : okazu) de soupes et de plats d’accompagnements était variable en fonction des circonstances du repas, si bien que le mot okazu devint synonyme de plat d’accompagnement. Ce mot est encore en usage de nos jours. Les trois plateaux sont servis en même temps devant le convive. Le nombre de plats d’accompagnement (okazu) est souvent symbolique et fait référence à la métrique poétique (chiffres 5-5-3 ou 7-5-3) ou à un chiffre faste: le groupement 7-5-3, par exemple, rappelle la fête des enfants âgés de 3, 5 et 7 ans (shichigosan), ces âges correspondant à trois étapes de la vie. On trouvera par exemple 3 plateaux avec sur l’un 7 plats, sur l’autre 5 plats et sur le troisième 3 plats, chaque plateau étant muni de soupe. Un repas de grande importance peut ainsi comporter un grand nombre de petits plats. Au début du repas on sert neuf coupes de saké accompagnées d’amuse-bouche. Les plats sont également porteurs de symboles soit en raison de leur nom soit en raison de leur homonymie avec un mot de bon augure.
 |
| Deux dames prenant un repas assistées par une servante. |
Comme dans beaucoup de pays, il existe au Japon une étiquette à table. La manière de se tenir, de manier les baguettes, l’ordre de dégustation des plats sont codifiés. Ils font l’objet d’un manuel pour les femmes publié en 1801. Par exemple, il faut alterner les aliments en se saisissant avec ses baguettes d’une ou deux bouchées de riz, puis d’un des ingrédients solides qui est dans la soupe, commencer par le plat à gauche du plateau et par les mets végétariens, prendre une bouchée de poisson, une bouchée de riz, etc. Chaque plateau comporte une soupe. Celle-ci sert de boisson pendant le repas, car le saké ou le thé ne sont traditionnellement servis qu’avant ou après le repas. Celui-ci se termine par un service de thé vert et, éventuellement, de saké.
Le repas kaiseki est de nos jours encore servi dans de bons restaurants au Japon. Le terme kaiseki correspond à 2mots homophones et fait référence à deux formes de repas : le premier est le kaiseki ryôri 会席 qui signifie repas de réunion assise et le kaiseki 懐石 qui peut se traduire « une pierre pour le ventre ». Ce dernier désigne le repas simple qui est servi lors de la cérémonie du thé. Il rappelle que les moines zen introduisaient une pierre chaude dans leur kimono pour résister au froid pendant leurs longues méditations et que celle-ci les empêchait de ressentir la faim. Le plateau pouvait comporter des petits plats d’accompagnement aux côtés du riz et de la soupe : la présence d’un plat chaud montrait que la cuisine était voisine de la salle de cérémonie du thé et par conséquent était une preuve de frugalité. Il comporte de nos jours tout de même 15 plats ! Le premier kaiseki fait référence aux réunions organisées par les shôgun dans leurs salles de réception et comportait un grand nombre de plateaux : on en dénombra 19 lors de la réception donnée par le shôgun Tokugawa au palais Nijô de Kyôto lors de la venue de l’empereur en 1626. ils étaient disposés sur une longueur de 40 mètres!.
Au Japon, le poisson est la base de l’alimentation avec les légumes, sous toute forme de présentation : crus, grillés, bouillis. L’alimentation carnée était assez limitée jusqu’à la venue des Occidentaux au milieu du XIXe siècle. Ainsi distinguait-on les animaux à 2 pattes (oiseaux) dont la dégustation était permise, des animaux à quatre pattes dont la viande était taboue. Les animaux de ferme étaient interdits à la consommation, ainsi que les animaux sauvages (cerfs, ours par exemple). Cependant, à certaines époques il est probable qu’il y eut une certaine tolérance vis-à-vis de cette dernière catégorie, car les paysans devaient se débarrasser des animaux qui ravageaient leurs récoltes. Les premiers restaurants apparurent au XVIIIe siècle, mais il fallut attendre la fin de ce siècle pour voir des échoppes servir de la viande crue, puis bouillie, ainsi que du gibier alors désigné sous le nom de « baleine de montagne », terme « élégant » pour désigner du cerf ou de l’ours !.
 |
 |
|
Petit déjeuner à Tamahan Ryokan, Kyoto. © Michael Maggs |
Plateau ozen. © Richard Mosdell |
L’exposition présente un certain nombre de récipients en céramique et en laque nécessaire au service de table, en particulier dans les restaurants que fréquentait Rosanjin. Elle s’ouvre sur des céramiques à décor d’émaux polychromes et d’or sur couverte dans l’esprit de la production de Kenzan et de Ninsei à Kyôto aux XVIIe et XVIIIe siècles et dans le goût de la peinture décorative de l’école Rimpa. Le décor des pièces fait allusion à des poésies en rapport avec les saisons, comme l’automne (feuilles d’érable), le printemps (cerisiers en fleurs) ou l’hiver (camélias). Les céramiques suivent un style renouvelé par des artistes de Kyôto au XIXe siècle comme Takahashi Dôhachi.
Afin d’adapter des plats au repas kaiseki ou au service du sushi, Rôsanjin opte pour des matériaux de diverses provenances. Il ressuscite ainsi des décors et des techniques de cuisson traditionnels, telles que les terres porcelaineuses d’Arita ou les terres à grès de Shigaraki et de Bizen.
Les pièces préférées de Rosanjin sont celles qui proviennent des fours de Seto-Mino, de Shigaraki et de Bizen. Ces fours, dont l’origine remonte à l’époque médiévale, ont produit à partir du XIVe siècle des pièces pour la cérémonie du thé dont les formes, les décors et les surfaces font preuve d’une grande innovation. Afin de respecter la tradition, Rosanjin a réalisé ses plats ou ses laques par set de cinq pièces (chiffre non tabou à la différence du chiffre 4 qui a pour homonyme un idéogramme signifiant la mort).
Rosanjin adopte aussi le style Oribe (du nom d’un grand maître de la cérémonie du thé de la fin du XVIe siècle) des céramiques de Mino. Pour ce faire, il utilise volontiers le procédé de « la division du corps » qui oppose une surface unie verte à une surface ornée d’un motif pictural sur des grès, matière préférée de Kitaoji Rosanjin. Le sulfate de cuivre produit cette tonalité verdâtre. Inspiré par les céramiques de type shino produites dans les fours de Mino au XVIe siècle, il utilise l’oxyde de fer pour créer des effets rougeâtres, conjuguant des engobes blancs et une couverte colorée.
Si certaines pièces respectent les formes traditionnelles, les imperceptibles déformations volontaires sont la marque de Rosanjin. Les coloris, quant à eux, sont plus vifs que sur les pièces anciennes. La technique de fabrication de la céramique kiseto (« Seto jaune »), également originaire de Mino, a été retrouvée par le potier Arakawa Tôyôzô auquel Rosanjin fait appel pour la réalisation de ses pièces. Celles-ci ont une couleur jaunâtre légèrement éclaboussée de sulfate de cuivre qui produit une teinte verte.
L’art de la table au Japon consiste à harmoniser les récipients et les mets, mais il doit aussi harmoniser ces deux éléments avec la saison, les goûts et le statut des invités. Ainsi, chaque repas est-il une œuvre d’art individualisée. Rosanjin avait pour habitude de dire que « les plats sont les kimonos de la cuisine ». En effet, le mets valorise le récipient et réciproquement celui-ci est exalté par les ingrédients qui y sont présentés, comme une femme vêtue de ses plus beaux atours.
D’autres céramiques présentées dans l’exposition rappelle la formation de Rosanjin à Kanazawa où il avait appris les techniques de décors en émaux polychromes rouge, vert et jaune des fours de Kutani.
 |
 |
|
Plat à couverte orangée de style shino. Collection particulière. © Christie’s |
Bols laqués pour la soupe au motifs de soleil et lune. Tokyo, collection particulière. Photo Sotaro Hirose © DR.jpg |
Mais ce sont aussi les grès de Bizen qui sont présentés sous diverses formes. Rosanjin avait demandé à Kaneshige Tôyô (plus tard nommé Trésor national vivant) de construire sur son terrain de Kita Kamakura un four d’un type particulier, nécessaire à la cuisson des grès de Bizen. Il put ainsi obtenir les fameux décors de « cordes de feu » : la pièce était emmaillotée dans de la paille de riz ; et, à la cuisson, l’alkali de la paille se combinait avec le fer de l’argile pour laisser des traces rougeâtres. Ce fut aussi le décor en « graines de sésame » qu’il utilisa, caractérisé par ses petit points jaunâtres de cendres de bois.
Les laques produits par Rosanjin pendant la guerre évoquent encore son passage à Kanazawa ville où cette technique est encore particulièrement préservée. La ville étant un centre minier aurifère, les décors sont caractérisés par l’utilisation de feuilles d’or. Les bols en laque sont utilisés pour servir la soupe, alors que les bols en céramique contiennent le riz. Les décors monochromes sont souvent préférés dans le cadre de la cérémonie du thé, alors que les pièces polychromes s’harmonisent avec d’autres pièces dans le service kaiseki.
Une des plus belles pièces de l’exposition reproduit, en grande taille, un coquillage dans le style de la production des fours de Hagi. Mais, dans les replis de la coquille, des amas d’émail translucide donnent de la profondeur à l’objet et l’illusion de se trouver devant un étang. Quoi de plus beau que cela pour présenter du poisson cru !
Céramiste, peintre et calligraphe, Rosanjin sut jouer de son talent pour combiner ces arts dans son travail de la porcelaine. Flacons et coupes à saké en donnent une idée, bien que Rosanjin fut bien connu pour ne pas aimer le saké et lui préférer la bière !
« La cuisine, tout en prenant comme motif la nature
et en satisfaisant le désir le plus primitif des êtres humains,
sublime ce savoir-faire au niveau de l’art. »
Kitaôji Rosanjin