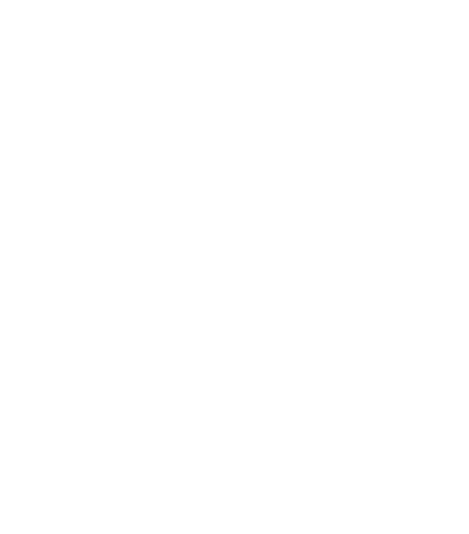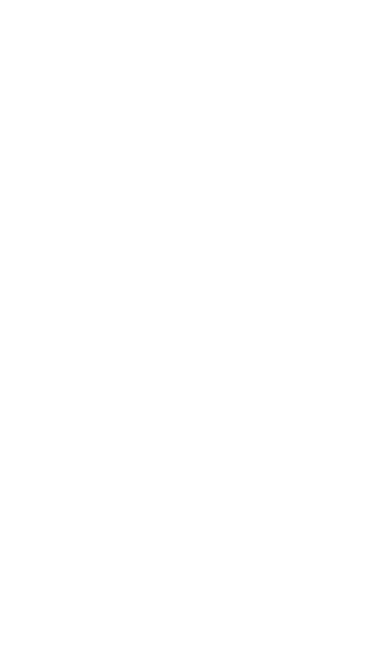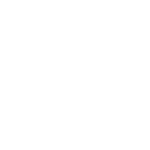Kimono
Visite de l’exposition Kimono au musée du Quai Branly-Jacques Chirac avec les commentaires de Julien Rousseau, conservateur des collections Asie au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.
Cette exposition a été organisée au Victoria & Albert Museum avant de venir à Paris. Elle présente cet emblème vestimentaire nippon depuis l’époque d’Edo (1603-1868) jusqu’à nos jours avec des adaptations occidentales.
Dès le 9ème s. est apparu un «proto-kimono» constitué de bandes étroites de tissus assemblées entre elles et noué sur le devant par une ceinture. À partir du 15ème s. le kosode, vêtement à emmanchures étroites, se porte seul et habille aussi bien les hommes que les femmes. C’est au 18ème s. que le terme de kimono (de kiru et mono, littéralement «chose que l’on porte sur soi») semble avoir été utilisé pour désigner un type de vêtement en général, mais les termes de kosode et d’osode sont toujours utilisés: le kosode désigne un vêtement aux «manches courtes» et tubulaires dont l’ouverture était juste assez grande pour le passage de la main et du bras, l’osode ayant des manches longues à ouvertures larges. Le kosode ne tient pas compte des différences anatomiques entre hommes et femmes et nécessite un maintien assez strict, surtout que le buste est maintenu par une large ceinture, l’obi, qui le corsète. Le kosode est constitué de 7 bandes de textile faisant 35cm de large qui sont assemblées de la même manière depuis des siècles. L’évolution du kosode va s’affirmer, non pas dans sa forme qui reste pratiquement inchangée, mais dans son décor.
C’est avec l’essor d’une classe urbaine enrichie par le commerce que le kimono devient un marqueur identitaire et social. Avec la stabilité politique instaurée par les shōgun Tokugawa et le transfert de la capitale à Edo (Tōkyō), on voit l’éclosion d’une production de textiles de luxe destinée aussi bien à la classe dirigeante qu’aux marchands «nouveaux riches» (chōnin) (ou aux banquiers de la noblesse, bientôt aux artisans, aux artistes et acteurs). Une estampe d’Utagawa Hiroshige (1797-1858) montre le magasin de kimonos Echigoya, fondé en 1673 et toujours florissant et célèbre en 1843.
 Vue de Surugachō de la série Lieux célèbres de la capitale orientale. Utagawa Hiroshige. Estampe polychrome. 1843-47. |
 Kimono de femme (furisode). Satin de soie damassé (rinzu), teinture par ligature. 1800-1850. |
Un somptueux furisode rouge, couleur symbolisant l’ardeur juvénile et la séduction très prisée par les jeunes femmes, est fait d’un satin de soie damassé teint au moyen d’une méthode longue et coûteuse, kanoko shibori (teinture par ligature). Malgré les lois somptuaires édictées par le shogunat qui interdit le vêtement rouge, les épouses de daimyō et de chōnin rivalisent d’audace et d’imagination et l’utilisent dans les doublures. Les motifs qui ornent les vêtements peuvent être en partie tissés, brodés ou teints. Les artisans rivalisent de virtuosité dans les broderies qui utilisent différents points et une variété de fils de soie de textures et de couleurs presque infinie sans oublier les fils métalliques. Si les motifs peuvent être abstraits, ils peuvent aussi être végétaux, se rapportant aux saisons, religieux avec des motifs bouddhiques, de bon augure, ou paysagistes. Un kosode en crêpe de soie présente une technique de teinture à main levée (yūzen), extrêmement coûteuse, qui permet de réaliser un paysage, en l’occurrence, les Huit vues de l’Ōmi, et les caractères brodés sont reliés au poème du même nom de Konoe Masaie (1444-1505). Un kosode du début du 18ème s. utilise la teinture yūzen, la teinture au pochoir, la broderie et les caractères brodés se rapportent à un poème sur la rose de montagne figurant sur le dessin. En plus du kimono, les élégantes portent un sur-kimono (uchikake) non moins somptueux. Pour l’été, le katabira, kimono fait dans un tissu plus léger à base de fibres de raphia, de chanvre ou de ramie, peut néanmoins porter un décor varié comme celui exposé qui illustre un épisode des Contes d’Ise avec sa représentation d’un étang d’iris. Le dos et les manches portent les armoiries du clan Tokugawa.
Les kimono ne comprenant pas de poches, les hommes portaient une petites boîte, inrō, accrochée à la ceinture et maintenue par un netsuke.
 Kimono de femme (kosode). Crêpe de soie, teinture à main levée à la colle (yuzen), broderies de soie et fils de soie dorés. 1730-1770. |
 Kimono de femme (kosode), détail. Ramie, teinture à main levée à la colle (yuzen), teinture au pochoir imitant la teinture par ligature, broderie de soie et de fils de soie dorés. 1680-1709. |
 Kimono d’été pour femme (katabira). Ramie, teinture à main levée par réserve à la colle (yuzen), teinture au pochoir imitant la teinture par ligature, broderie de soie et de fils de soie dorés. 1800-1850. |
Avec le temps, les courtisanes et les acteurs de kabuki devinrent des lanceurs de mode. Ces derniers, depuis le 17ème s., jouaient les rôles féminins et les plus célèbres, porteurs de somptueux vêtements sur scène, étaient la coqueluche du public et leurs tenues souvent imitées. Une estampe d’Utagawa Toyokuni (1769-1825) montre l’acteur Ishikawa Danjūrō VII portant un costume de scène orné d’une faucille, d’un motif wa et du caractère nu, qui peuvent se lire kamawanu qui signifie «je n’en ai rien à faire». On raconte que les admirateurs de l’acteur se précipitèrent pour acheter des tissus et des mouchoirs portant ces motifs ! Un kosode ayant été porté par l’acteur Ishikawa Danjūrō IX est orné de carpes bondissantes, motif de bon augure. Les kimonos rouges avec motifs teints par nouage en forme de feuilles de chanvre étaient associés aux courtisanes mais un furisode du début du 19ème s. pourrait avoir été porté par une jeune femme de la classe marchande souhaitant suivre la mode du quartier de plaisir.
 L’acteur Ishikawa Danjūrō VII. Utagawa Toyokuni (1769-1825). Estampe polychrome. 1805-1810. |
 Rue nakano dans le quartier de Yoshiwara (détail). Utagawa Hiroshige (1797-1858). Estampe polychrome. 1857. |
 Sur-kimono (uchikake). Satin de soie appliqué et broderie en fils de soie et fils de soie métallisé or. 1860-1880. |
Une estampe d’Utagawa Hiroshige II (1826-1869) représente la Rue Nakano dans le quartier de Yoshiwara dont le plus grand spectacle était le défilé des courtisanes de haut rang (oiran) vêtues des tenues les plus extravagantes. Un sur-kimono de femme (uchikake) fait de satin de soie orné de broderies de fils de soie et de fils dorés a pu être porté à cette occasion. Les motifs se rapportent à une pièce de kabuki illustrant ainsi les liens étroits entre le théâtre et les maisons closes.
Les tissus d’importation pouvaient également servir à la confection de vêtements au Japon. Un sous-kimono masculin (juban) fut confectionné dans un tissu fabriqué en Inde, exporté vers la Thaïlande pour être finalement apporté au Japon par un marchand néerlandais. Un autre est confectionné dans une cotonnade imprimée de motifs floraux pour tissu d’ameublement anglais ou français.
Si le pyjama est d’origine indienne, la robe de chambre vient du Japon. L’exemplaire le plus ancien d’origine japonaise pourrait être rattaché au «kimono de soie aux blasons familiaux» que les archives japonaises rapportent avoir été chargé sur un navire néerlandais en 1711. Qu’elles soient luxueuses ou modestes, les «japonse rock», fabriquées pour l’exportation, vont se répandre dans toutes l’Europe.
 Sous-kimono d’homme (juban). Soie tissée unie, coton (Japon), coton, teinture par mordançage et par réserve (Côte de Coromandel, Inde). 1800-1850. |
 Robe de chambre. Japon. Tissage de soie uni, teinture par réserve au pochoir (katazome). 1700-1720. |
 Sous-kimono d’homme (juban), détail. Laine imprimée. Les motifs de voitures, de trains, de voiliers, de seaux et de pelles reflètent la possibilité de voyager au bord de la mer. 1925-1940. |
A partir de l’ère Meiji (1868-1912) le décor des kimonos va se modifier et se moderniser. Si les hommes adoptent le costume occidental, les femmes appartenant à l’élite vont continuer de porter le vêtement traditionnel pour les cérémonies même si elles s’essayent aux modes venues d’Europe ou d’Amérique dans la vie courante. Le grand magasin Mitsukoshi ou les boutiques Takashimaya ou Daimaruya vont être des acteurs essentiels dans la voie de la modernisation.
En contrepartie, la vogue du japonisme va envahir l’Occident et le peintre anglais Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), se rendant chez Madame de Soye à Paris, est fort désappointé lorsqu’il apprend qu’un autre peintre, James Tissot (1836-1902), a acquis tout le stock de kimonos ! Les couturiers, au tournant du siècle, vont s’inspirer du kimono et Paul Poiret (1879-1944), pionnier du drapé, utilisa ses formes amples, comme on peut le voir sur un manteau du soir, de 1913.
 Manteau de soirée. Paul Poiret (1879-1944). Soie, velours, broderies de fils métalliques. 1913. |
 Kimono destiné à l’export. Satin de soie (shusu), broderies de fils de soie. 1905-1915. |
 Kimono d’été. Yamaguchi Genbei (né en 1948). Chanvre filé mécaniquement (taima-fu), teinture par ligature (nuishime shibori). 2019. |
Après la seconde guerre mondiale, les créateurs, aussi bien occidentaux que japonais, vont utiliser des tissus japonais ou les formes du kimono pour un renouveau de ce vêtement qui incarne une élégance universelle. Dans les années 1960, les couturiers japonais s’installent à Paris comme Kenzo (1939-2020) puis Issey Miyake (1938-2022). Ce dernier triomphe avec ses vêtements droits et plissés. Yves Saint Laurent (1936-2008), Jean-Paul Gaultier (né en 1952) et John Galliano (né en 1960) vont ainsi s’inspirer des formes du kimono mais aussi des tissus et des décors japonais.
Les stars, la pop culture et le cinéma vont aussi participer à la diffusion de la forme du kimono et de David Bowie à Madonna, de Blade Runner à Star Wars, les références ne manquent pas…
Pour conclure, la commissaire de l’exposition, Anna Jackson, présente la collection «Wafrica», concept de l’artiste camerounais Serge Mouangue, où il interprète les formes traditionnelles du kimono avec des tissus africains, insistant sur le fait qu’une identité culturelle est nourrie d’échanges.
 Manteau et robe «Nihon Buyo». Issey Miyake (1938-2022). Polyester plissé. 2016. |
 Costume pour la reine Apailana dans Star Wars Épisode III de George Lucas (né en 1944) et costume de Mifune Toshirō dans Sanjūrō de Kurosawa Akira (1910-1998). |
 Kimono réalisé pour Wafrica. Serge Mouangue (né en 1973). Bogolan, tissu malien teint selon une technique particulière à base de boue fermentée et d’écorce de mpecou. 2016. |