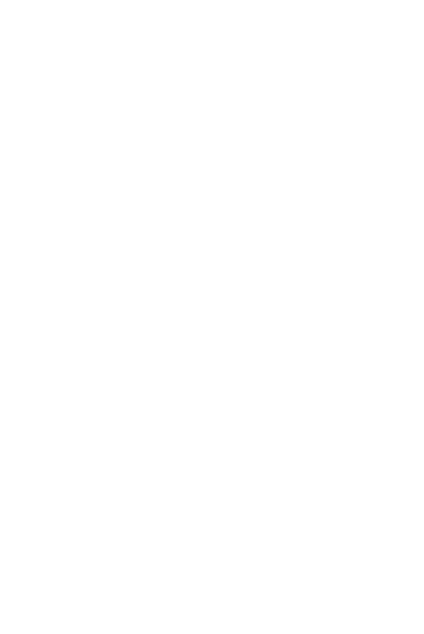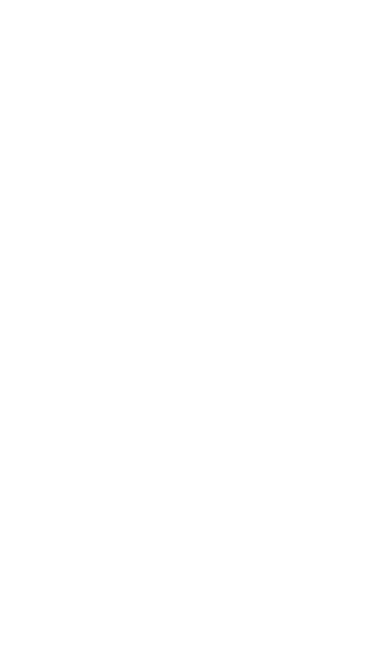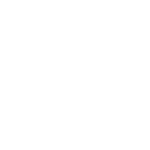Kimono-au bonheur des dames
Mercredi 8 mars 2017 : Kimono-au bonheur des dames au MNAA Guimet, visite conférence par Sylvie Ahmadian, Conférencière spécialisée en art asiatique, attachée au musée Guimet.
La collection présentée provient de la vénérable maison de mode féminine, Matsuzakaya, fondée en 1611 à Nagoya, au début de l’époque d’Edo (1603-1868). Cette collection, débutée en 1931, présente un panorama de la mode féminine japonaise, elle est pour la première fois exposée en dehors du Japon.
En 1745, une succursale Matsuzakaya a été implantée à Ueno, dans Edo (actuelle Tokyo). Des catalogues de modèles furent édités par la maison Matsuzakaya et 180 éditions ont été publiées en deux siècles, la première remontant à 1666. On y voit les kimonos de dos avec des motifs différents ; les clientes choisissaient un modèle et un vendeur du magasin leur montrait un patron grandeur nature en précisant tous les détails. Ces catalogues ont, parfois, fait évoluer la mode et les femmes les achetaient comme on achète aujourd’hui un magazine féminin.
 Angyusai Enshi. Vue intérieure de la boutique d’Ueno (Maison Matsuzakaya). 1772. Impression polychrome nishiki-e. Détail d’un polyptyque. |
 Exemple de catalogue en trois volumes édités par la Maison Matsuzakaya en 1704. |
L’époque d’Edo voit le Japon se replier sur lui-même et ne garder que des relations sporadiques avec la Chine, la Corée et la Compagnie des Indes néerlandaises. Ceci entraîne, pour les artistes, un retour aux traditions et les Japonais vont développer dans tous les domaines une production artistique d’une grande originalité et d’une extraordinaire richesse. Le système politique et social institué par le Shogunat oblige les nobles à posséder une résidence à Edo et répartit la société en trois classes : les guerriers (buke) (shogun, famille impériale, samouraïs et nobles), les paysans et, dans la couche inférieure de la société, les artisans et les commerçants (chonin). Conséquence de l’enrichissement de ces derniers, le pouvoir économique va se déplacer, et nombre de marchands vont être plus riches que beaucoup de nobles. Comme ils n’avaient pas le droit de posséder de résidences à la campagne ou de palais en ville, ces marchands vont dépenser leur argent dans les divertissements et c’est à ce moment-là qu’apparaissent les quartiers de plaisir dont le fameux Yoshiwara à Edo (Tokyo).
Lorsque la capitale a été déplacée à Edo en 1603, celle-ci est devenue le centre économique et artistique du Japon. On y retrouve toutes les activités artisanales et des ateliers de tissage y ont aussi été créés, mais le centre de tissage des textiles les plus luxueux reste Kyoto, la capitale impériale.
On ne sait pas exactement à quelle époque le kimono a été introduit au Japon mais il est attesté dans sa forme kosode à l’époque Heïan (794-1185) et, à l’époque Kamakura (1185-1333), c’est le vêtement porté au quotidien par la classe guerrière. A partir de l’époque d’Edo, les marchands et les bourgeois vont aussi adopter le kosode en soie. C’est au 18ème s. que le terme de kimono (de kiru et mono, littéralement « chose que l’on porte sur soi) semble avoir été utilisé pour désigner un type de vêtement en général, mais les termes de kosode et d’osode sont toujours utilisés : le kosode désigne un vêtement aux « manches courtes » et tubulaires dont l’ouverture était juste assez grande pour le passage de la main et du bras, l’osode ayant des manches longues à ouvertures larges. Le kosode ne tient pas compte des différences anatomiques entre hommes et femmes et nécessite un maintien assez strict, surtout que le buste est maintenu par une large ceinture, l’obi, qui le corsète. Le kosode est constitué de 7 bandes de textile faisant 35cm de large qui sont assemblées de la même manière depuis des siècles. L’évolution du kosode va s’affirmer, non pas dans sa forme qui reste pratiquement inchangée, mais dans son décor.
Une peinture de Moronobu Ishikawa (1618-1694) représentant une « belle femme debout » illustre le fait qu’on pouvait porter plusieurs kosode superposés.
Un kosode du 18ème s. en crêpe de soie, présente un décor typiquement japonais de parois de papier et de mélèzes qui associe des motifs géométriques à des motifs naturalistes.
 Moronobu Hishikawa. « Belle femme debout ». Couleurs sur papier. Fin 18e s. |
 Kosode à motifs de mélèzes et parois de papier. Teinture à réserve sur crêpe de soie. Début 18e s. |
 Kosode à motifs de lignes ondulantes et chrysanthèmes. Soie brochée karaori. Détail. 2e moitié du 16e s. ©Sylvie Ahmadian. |
Un kosode du 16ème s. à motifs de lignes ondulantes et de chrysanthèmes a été réalisé dans une soie brochée karaori (méthode de tissage dans laquelle les fils de chaîne de soie grège et la trame de soie ouvrée donnent l’impression d’une broderie) particulièrement somptueuse.
Les tissus utilisés peuvent être simplement teints, brodés, avec des motifs teints en réserve (yuzen zome) tel le kosode à motifs d’eau vive et iris : les motifs sont d’abord dessinés en réserve avec la technique du bosen (de la colle est appliquée afin de repousser la teinture) puis teints en couleur indigo. Le tissu est ensuite passé à la vapeur qui va fixer la teinture et éliminer la colle. Les motifs d’iris et d’eau vive ont ensuite été délicatement brodés. Pour certains tissus luxueux, la colle des motifs est appliquée au pinceau, ce qui permet des compositions paysagères très savantes. Une autre technique, le shibori zome, consiste à ligaturer ou coudre certaines parties du tissu, de les enduire de colle afin de les rendre imperméables avant de plonger l’étoffe dans la teinture. Enfin, la technique du pochoir, katagami, permet d’obtenir des zones ou des motifs en réserve qui pourront éventuellement être peints ensuite. Parfois, trois techniques peuvent être employées dans le décor d’un kimono en plus des broderies.
Un kosode en satin blanc orné de chrysanthèmes brodés est typique de la mode du 17ème s. avec une ornementation qui part de l’épaule gauche pour finir vers l’ourlet du côté droit, traçant un arc de cercle dans une composition très dynamique.
 Kosode à motifs de chrysanthèmes. Teinture kanoko shibori et broderies sur satin de soie blanc. 2e moitié du 17e s. ©MNAAGuimet |
 Katabira à motifs de camélias, fleurs de cerisier et chauves-souris. Teinture à réserve, broderies et couchure de fils d’or sur lin bleu. Fin 18e s. – début 19e s. |
 Uchikake à motifs de quarts de cercle successifs et jeunes pins. Teinture à réserve sur soie damassée. 1e moitié du 19e s. |
Au 18ème s., les femmes de la classe guerrière buke vont privilégier les soies damassées ou les crêpes de soie agrémentés de broderies, parfois, le shibori zome est aussi utilisé.
L’uchikake est un vêtement de dessus, ample et lourd, il se porte sans ceinture.
Les katabira sont des kosode informels portés à l’intérieur des maisons, particulièrement durant l’été. Ils sont non doublés et généralement en lin. Un exemple somptueux, du 18ème s., en lin bleu, est rehaussé de fleurs de camélias et de cerisiers ainsi que de chauves-souris au niveau des épaules. La teinture est faite à réserve et les motifs sont en broderies et couchure de fils d’or.
Le furisode est un kosode doté de manches longues, plus particulièrement porté par les jeunes filles. Un exemple en soie jaune brodée, du début du 19ème s., présente un décor illustrant la fête des feuilles rouges et jaunes de l’automne. C’est avec une finesse extrême que les motifs, d’abord en réserve, puis brodés, partent de l’ourlet en bas du dos pour remonter jusqu’au col sur le devant. Ils évoquent des thèmes puisés dans le Dit du Genji. Les motifs d’inspiration théâtrale ou littéraire abondent dans les décors des kimonos, montrant ainsi que la propriétaire est une femme cultivée.
 Furisode avec illustration de la fête de feuilles jaunes et rouges d’automne. Détail. Teinture Yuzen et broderies sur fond de soie jaune. Début 19e s. |
 Trousseau de mariage en laque maki-e et accessoires. Début 19e s. |
 Uchikake à motif d’étui contenant des coquillages à jouer. Teinture kanoko shibori et broderies sur un fond de soie damassée. Début 19e s. |
Le mariage d’une jeune fille permet de déployer un luxe extraordinaire dans les trousseaux. Ces trousseaux de mariage pouvaient comprendre entre 300 et 500 pièces laquées, souvent en laque maki-e décoré d’or ou d’argent. Tous ces objets n’étaient pas toujours destinés à un usage quotidien et ils constituaient un patrimoine et étaient transmis d’une génération à l’autre, en tant que trésor familial. Un trousseau de mariage de la fille d’un seigneur féodal du début du 19ème s. montre la diversité et la richesse des meubles et accessoires, tous ornés de pivoines, armoiries (ka-mon) de la famille Takatsukasa, et de motifs de losanges en maki-e sur fond noir. Des étagères avec coffre supportaient les nécessaires pour la cérémonie de l’encens, ceux pour la toilette et le maquillage, les fournitures de bureau et l’écritoire. Lors de son mariage, la jeune fille devait posséder plusieurs uchikake qu’elle changeait au cours de la journée.
Un uchikake de mariage somptueux, en soie damassée blanche, est brodé de motifs d’étuis contenant des coquillages à jouer (kai-awase). Ce jeu, très apprécié des femmes, permettait de mettre en avant sa culture littéraire et picturale.
 Paire d’épingles avec pendants, ornées de pivoines et d‘hortensias. Début 19e s. |
 Obi à motif de chars à bœufs, bambous, et mauves. Broderies sur crêpe de soie. Début 19e s. |
 Kosode avec représentation du Grand Sanctuaire Sumiyoshi. Teinture yuzen et broderies sur fond de soie damassée. Milieu 18e s. |
 Kosode à motifs d’orchidées sous la neige et caractères calligraphiés. Teinture yuzen, teinture nori bosen et broderies sur crêpe de soie indigo. 2e moitié du 18e s. |
Comme les kosode, les coiffures ont aussi évolué au cours des siècles. Alors qu’à l’époque Heïan, les cheveux étaient très longs, descendant jusqu’à terre et juste resserrés par un lien dans le dos, les façons d’arranger les cheveux au-dessus des épaules se sont beaucoup développées à l’époque d’Edo, peut être à l’instigation des courtisanes. Pour maintenir ces chignons très complexes, laissant la nuque à découvert (partie la plus sensuelle et érotique du corps humain pour les Japonais), on utilisait toutes sortes de peignes et d’épingles. Les peignes décoratifs pouvaient être réalisés en bois laqué, en ivoire ou en écaille de tortue. Les épingles étaient généralement en métal et ornées de différents motifs végétaux ou animaux et certaines présentaient des pendants qui bougeaient lorsque la femme marchait ou remuait la tête.
Un élément essentiel du costume japonais est l’obi, grande ceinture qui permettait de maintenir le croisé du kimono fermé. Porté par les hommes et les femmes, l’obi est cependant beaucoup plus long et plus richement décoré pour ces dernières. Un exemple en crêpe de soie violet est orné de riches broderies de bambous, de mauves et de chars à bœufs alors qu’un autre, en satin blanc, est brodé de légers motifs de pins, de bambous et de pruniers.
A partir du 18ème s., la mode va favoriser les motifs calligraphiés et les paysages. Un kosode du milieu 18ème s. est orné de paysages brodés d’une remarquable délicatesse s’apparentant à la peinture. Il fait référence au Grand Sanctuaire Sumiyoshi dans la préfecture d’Osaka. Un kosode en crêpe de Chine de la même époque présente un décor à motifs d’orchidées recouvertes de neige et caractères calligraphiés d’un poème waka tiré du Dit du Genji.
A partir de l’ère Meiji (1868-1912), le Japon entre dans la modernité et la classe supérieure va abandonner le port du kimono au profit des vêtements occidentaux. Les autres classes sociales vont continuer à porter le costume traditionnel mais on voit une évolution dans les teintures qui deviennent synthétiques, permettant une plus grande variété de couleurs que les pigments naturels. Un hitoe violet intense, à motifs de cerisiers et de pivoines, teint à réserve, est un bon exemple de la production de la fin du 19ème s.
 Hitoe à motifs de cerisier et pivoines. Teinture à réserve sur crêpe de soie. Fin 19e s. |
 Manteau « Casanova » à larges manches kimono par Callot Sœurs. Crêpe de chine, filé lamé. 1925. |
 Manteau-mandarin, matelassé de soie, imprimé tilleul et glycine vert et violet. Yves Saint Laurent. 1994. |
 Kimono « Oiran ». Soie et polyester. Junko Koshino. 2009 |
La découverte du Japon par les Occidentaux aux Expositions universelles va entraîner une mode japonisante dans tous les domaines artistiques. Les robes d’intérieur vont reprendre la forme des kimonos et surtout on va utiliser des soieries japonaises. Les créateurs de mode du début du 20ème s. vont s’inspirer dans les formes et les décors de cet exotisme japonais. Un manteau « Casanova » des sœurs Callot reprend les larges manches kimono et la richesse du décor n’est pas sans évoquer les vêtements de cour japonais. Paul Poiret va lui aussi sacrifier à la mode japonisante en créant une robe portefeuille en crêpe de soie, croisée sur le devant, avec de longues manches et un décor asymétrique.
Après la mode du japonisme de la fin du 19ème s. et du début du 20ème s., le Japon ne va plus être à la mode et il faudra attendre les années 1960, période où des créateurs japonais vont arriver à Paris, pour voir de nouveau la mode s’inspirer et réinterpréter le kimono. Kenzo, puis Issey Miyake vont puiser leur inspiration dans le patrimoine culturel japonais et insuffler un nouveau japonisme dans la mode. Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier et John Galliano vont ainsi s’inspirer des formes du kimono mais aussi des tissus et des décors japonais.
Une créatrice japonaise contemporaine, Junko Koshino, s’attache à respecter l’âme du kimono et l’esprit du Japon tout en créant des vêtements faciles à porter. Pour le kimono Oiran (nom donné aux courtisanes de l’époque d’Edo), elle reprend les exagérations de la mode de l’époque en les modernisant. Elle utilise aussi toutes les ressources des tissages traditionnels tels que broderies au fil d’or, applications de feuilles de métal ou insertions de lamelles de papier doré.