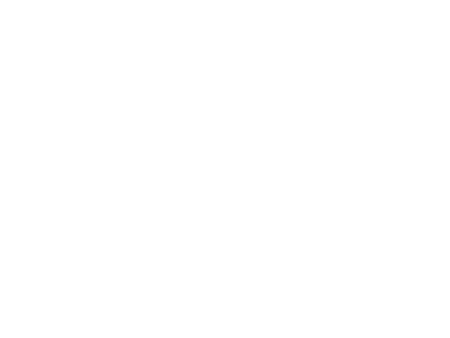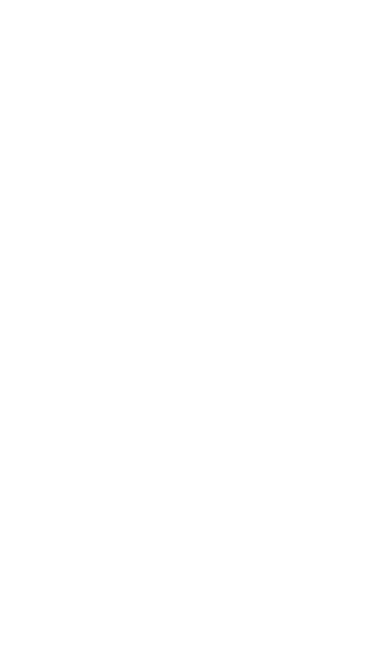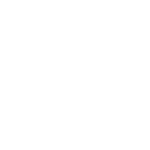Shôkokuji, pavillon d’Or, pavillon d’Argent, art et Zen à Kyôto
Mercredi 3 décembre 2008
Compte rendu de la visite-conférence « Shôkokuji, Pavillon d’or, Pavillon d’argent, Art et Zen à Kyôto », par Madame Percin de Sermet, conférencière attachée aux musées Cernuschi et Petit Palais.
Notre charmante conférencière nous a d’abord rappelé que 2008 était l’année anniversaire des cent cinquante ans de relations franco-japonaises et surtout des cinquante ans du pacte d’amitié entre Paris et Kyôto.
Madame Percin de Sermet a souligné, comme le professeur Macé l’avait fait précédemment, que la pratique du Zen, bouddhisme de la méditation, a connu son apogée durant la période Muromachi (1333–1582), l’une des plus troublées de l’histoire du Japon.
Yoshimitsu (1358-1408), le troisième shôgun de la dynastie Ashikaga installe le gouvernement à Muromachi, quartier de Kyôto proche du palais impérial. Non loin de là il fait construire en 1392, le Shôkokuji, dernier des temples des Cinq Montagnes à Kyôto, mais qui fut aussi, durant une brève mais brillante période, le temple majeur du groupe. Ce temple connut nombre de vicissitudes : plusieurs incendies dus aux accidents, presque complètement rasé durant la guerre civile d’Ônin (1467-1477). Cependant, toujours reconstruit, il reste le prototype des temples officiels, de facture purement Zen.
Yoshimitsu se retira pour prendre l’habit monastique et se fit construire, à l’ouest de la ville, une résidence somptueuse combinant palais et temple : le Kinkakuji ou pavillon d’Or.
Son exemple fut suivi par son petit fils, Yoshimasa (1436-1490), huitième shogûn Ashikaga, qui fit aménager, à l’est de la capitale, une retraite moins somptueuse mais plus élégante : le Ginkakuji ou pavillon d’Argent.
Portraits
Après ce résumé historique nous nous sommes arrêtés devant la statue en bois (N°90) de Musô Soseki (1259-1351). Bien que mort trente ans avant la construction du Shôkokuji, il est considéré comme le premier patriarche et « celui qui a ouvert la montagne ». En fait c’est son neveu et disciple, Sun’oku Myôha, n’acceptant d’être patriarche que s’il était le second après son maître, qui en fut le premier.
Le portrait est d’un réalisme saisissant, non seulement par le visage qui est généralement rendu avec fidélité dans la statuaire zen, un portrait peint (N°89) situé à proximité démontre la parfaite ressemblance, mais aussi par la frêle carrure et les épaules tombantes. Revêtu de la robe monastique, il est assis sur un trône, en position de méditation. Son bâton d’enseignement, symbole de pérégrination et de pouvoir, posé à ses côtés.
Le portrait peint (N°92) de Sun’oku Myôha, réalisé par Kanô Tan’yû (1602-1674) est très nettement influencé par la peinture chinoise. Ces portraits étaient censés être le reposoir de l’âme du moine défunt et pouvaient être l’objet d’une dévotion bien que le zen soit basé sur la méditation.
Le portrait peint (N°94) et celui sculpté (N°96) d’Ashikaga Yoshimitsu le représentent en moine zen, assis sur un trône et portant le kesa, la robe monastique. Le troisième shôgun éprouvait une fascination pour la culture chinoise et possédait une collection importante de peintures et porcelaines des dynasties Song et Yuan. Ces deux portraits ont été réalisé après la mort de Yoshimitsu et sont d’un moindre réalisme.
La statue (N°97) de Kûkoku Myôô (1328-1407), troisième patriarche du Shôkokuji, montre un grand réalisme dans le traitement du visage mais la construction générale reste conventionnelle.
La sculpture monumentale du « phénix » en bronze (N°98), autrefois doré, est la pièce originale qui ornait la boîte faîtière du Kinkakuji et reste la seule pièce qui subsiste de l’ancien pavillon d’Or brûlé en 1950.
Peintures et lavis d’encre
Malgré un antiritualisme affiché, la pratique du zen reste essentiellement une pratique rituelle, comme nous l’avait déjà rappelé le professeur Macé.
Deux divinités bouddhiques ont été particulièrement vénérées dans le bouddhisme zen : Kannon à la robe blanche (une forme du boddhisattva de la compassion : Avalokitešvara ou Guanyin en Chine) et Monju (Mañjušri : le boddhisattva de la connaissance). L’esthétique des Song était particulièrement prisée au quatorzième siècle et les premiers monastères zen utilisèrent des peintures importées de Chine qui influencèrent ensuite la production locale.
Les représentations peintes de Kannon à la robe blanche la montre souvent assise en position de délassement sur un rocher, près d’un cours d’eau (N°143) ou dans une grotte (N°144), rappel de l’érémitisme prôné par le zen, avec, à ses pieds, un dévot ou un enfant. Une autre représentation, de grand format (N°146), la montre debout, légèrement tournée vers sa droite et tenant une fleur de lotus. Ce rouleau était utilisé une fois par an lors du rituel du repentir.
Ces œuvres furent exécutées par des moines peintres utilisant la technique de l’encre rehaussée de couleur.
Monju qui connut un grand succès dans le bouddhisme zen est illustré par un grand rouleau vertical : « Monju au vêtement de corde » (N°148). Le personnage est figuré avec les cheveux lâchés, tombant jusqu’à ses pieds nus, enveloppé dans un long vêtement de corde et tenant dans ses deux mains un recueil de sûtras. Ici encore le rappel de l’érémitisme est flagrant.
L’œuvre du peintre chinois Mu Qi (première moitié du XIII° s.) montrant Hanshan (montagne froide), Shide (ramasse-miettes) et Fenggan (N°149), illustre bien le caractère caricatural et excentrique de certaines peintures zen. En comparaison, le rouleau « voyageurs franchissant la montagne froide » (N°167) attribué à Zhang Yuan (Chine XIV° s.) démontre l’élégance et la maîtrise du pinceau propre à la peinture de paysage au lavis et évoque la tradition de la peinture « montagnes et eau ».
Daruma (Boddhidharma, considéré comme le fondateur du bouddhisme chan) sur la feuille de roseau (N°154) est l’œuvre d’un moine lettré, Gukyoku Reisei (1363-1452). Ici, le travail de l’encre sur la soie est d’une grande fluidité malgré l’économie de moyens.
Un autre moine du Shôkokuji, Shûbun (XV° s.), est l’auteur présumé d’un dyptique illustrant deux « scènes d’édification », le chien de Zhaozhu et Yantou en passeur (N°157, N°158). Ces « scènes d’édification » représentent l’incident qui apporta l’illumination aux maîtres ou des épisodes de leurs vies portant un enseignement. Elles jouent généralement sur le côté narratif et concret de la scène.
Les « arhat » (N°173) attribué Kanô Monotobu (1476-1559) reprend l’allure burlesque des personnages dans un paysage traité avec soin alors que « la réponse de Deshan » (N°174), attribué à Kaihô Yûshô (1533-1615), autre « scène d’édification », montre un style épuré presque sévère.
Le rouleau « branches de prunier blanc et de prunier rouge » (N°171) par Motsugai (début XV° s.) reprend un modèle de la dynastie des Song. Il utilise un tracé délié et fait preuve d’une grande habileté pour rendre à l’encre monochrome le contraste entre les deux branches.
Chanoyu (cérémonie du thé)
Comme en Chine, le thé a d’abord été considéré comme une boisson médicinale, puis fut servi lors de cérémonies bouddhiques et les temples étaient les principaux producteurs de thé. Au japon comme en Chine la consommation de thé fut souvent associée à la poésie. Le huitième shôgun, Ashikaga Yoshimasa(1436-1490), érudit et raffiné, fut le plus grand collectionneur d’art chinois de son temps et c’est à cette époque que se développa la poésie en langue japonaise, l’art des bouquets et de l’encens, les débuts du thé. Son portrait (N°205), bien que datant du XVIII° s. transmet bien le raffinement du shôgun.
Au XIV° et XV° siècles la noblesse japonaise vivait à l’heure du basara, de « l’extravagance » et l’on importait des objets luxueux de Chine pour la décoration ou la préparation du thé. Les bols en céladon de Longquan (N°199, N°200) ou les tenmoku (N°202) des Song du Sud étaient particulièrement prisés et furent imités par des fours locaux (N°201).
Sen no Rikyû (1522-1591) est certainement le plus célèbre maître de thé et c’est à lui qu’on doit un renversement des tendances. Il prôna le wabicha, « thé dans le style des pauvres » et codifia de façon quasi définitive la cérémonie du thé. Sous son influence, les différents objets nécessaires à la cérémonie semblent frustres et les imperfections deviennent un critère esthétique, c’est aussi lui qui fit créer la céramique de type raku. L’exposition montre quelques objets lui ayant appartenu : cuiller à thé dans son étui en bambou (N°215,N°216), porte-bouquet en bambou (N°217), bol en grès de type setoguro (N°218). Malgré cette apparente simplicité, la cérémonie du thé reste un marqueur social et ne peut être réalisée que par des personnes cultivées.
Noromura Ninsei (XVII° s.), artisan qui apporta des améliorations techniques et stylistiques à l’art de la poterie est représenté par trois bols à thé de style très différent : le N° 223 dans le style coréen, le N° 224 en grès décoré d’une peinture zen montrant Kanzan et Jittoku, le N°226 en grès à décor polychrome qui combine plusieurs techniques.
Le zen dans le Japon d’Edo
Nous avons fini la visite par la salle consacrée à la peinture de la période Edo (1615-1867). Ito Jakuchû (1716-1800) montre ici les différentes facettes de son art. La grande triade (N°249-251) Shaka entouré de Monju et Fugen (Šâkyamuni, Mañjušri, Samantabadhra) suit un modèle chinois attribué à Zhang Sigong (Chine dyn.Song) et son style très conventionnel convient à une œuvre destinée au culte public, loin de la peinture méditative. Le dragon (N°262) comme la carpe bondissant (N°261) sont traités dans un style alerte, au pinceau délié, transmettant bien la notion de mouvement et de liberté chère au zen.
Cette exposition illustre parfaitement combien l’art zen peut être protéiforme.