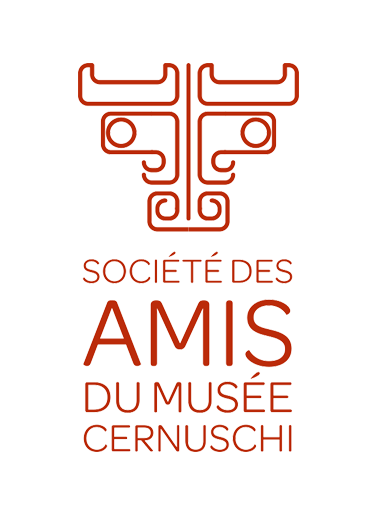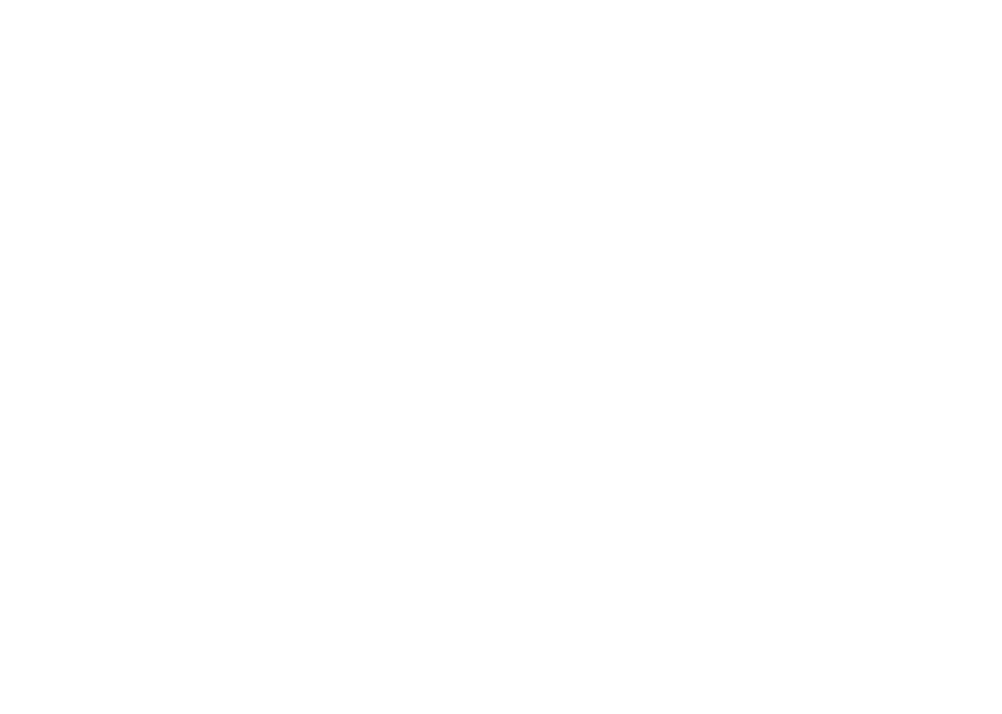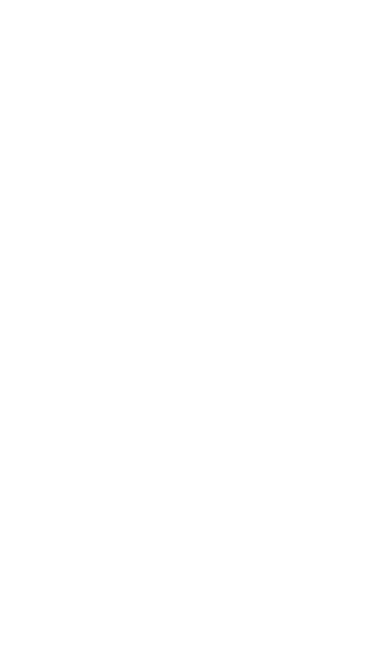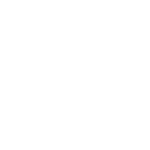Japon(n)erie, japon(i)aiserie, japonisme
Conférence de Sophie Basch, professeur à Sorbonne Université, membre de l’Institut universitaire de France.Au cours de cette conférence, Sophie Basch a mis en lumière les différentes nuances permettant de caractériser les arts inspirés du Japon.
Le japonisme, mouvement occidental de réception des arts du Japon, connaît son âge d’or à Paris. Si l’approche anglo-saxonne est plus immédiatement érudite, et de ce fait plus respectueuse des hiérarchies et des catégories esthétiques japonaises, l’histoire de l’art japonais s’est davantage confondue en France avec l’histoire des collections particulières, lesquelles ont été le véritable creuset du japonisme avant qu’il ne s’étende aux collections publiques grâce à la générosité de collectionneurs mécènes. Il faut toutefois attendre l’entrée de deux sculptures japonaises au Louvre en 1891, l’inauguration du musée Cernuschi en 1898 et les expositions universelles qui closent « l’ère du bibelot, de la curiosité mercantile » pour ouvrir celle de « l’influence artistique » (Edmond Pottier) afin que soit pleinement reconnu l’art japonais.
Face à l’engouement du Japon chez les artistes français, Michel Melot congédie l’explication exotique : le japonisme n’est pas un orientalisme. Il faut chercher du côté de la parenté que se découvrent les artistes français avec les Japonais pour comprendre que ce qui unit l’impressionnisme et le japonisme est « plus qu’une coïncidence circonstancielle, mais un lien profond, dont l’explication gît dans la situation, à un moment semblable, des deux civilisations qui s’ignorent ». L’année 1856 marque celle de la découverte des estampes japonaises pour les artistes Félix Bracquemond et Claude Monet, tandis que Baudelaire évoque ce nouvel attrait par le terme de « japonerie » dans une lettre de Baudelaire à Houssaye datant de décembre 1861 : « Il y a longtemps, j’ai reçu un paquet de Japonneries que j’ai partagées entre mes amis et amies […] c’est d’un grand effet ».
Le mot japonerie revient plus tard dans le catalogue de la deuxième exposition des peintres impressionnistes pour désigner une toile de Monet que l’on connaît aujourd’hui sous le titre La Japonaise. Selon Ségolène Le Men, l’œuvre ne cède pas ici à une vogue exotique mais manifeste « de façon provocante et parodique tout ce que l’estampe japonaise et la mode occidentale du japonisme apportent à la peinture moderne ». L’idée de japonerie est de plus en plus dépréciative et devient presque synonyme de japoniaiserie.
 Claude Monet, La Japonaise, Madame Monet en costume japonais. 1876. Huile sur toile. |
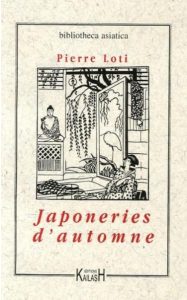 Pierre Loti. Japoneries d’automne. 1889. |
C’est en 1867 que l’on note la première occurrence notable du terme « japoniaiserie ». Au retour d’un séjour raté à Trouville, Jules de Goncourt quitte le collectionneur Philippe Burty et lui promet de passer « douze heures de fête à [se] donner une indigestion à l’exposition, sur ce cri de ralliement : Japonaise-rie for ever ». Le mot est calqué sur « chinoiserie », terme omniprésent au 18e siècle pour qualifier les meubles et objets européens inspirés par l’exotisme oriental chinois, même si c’est ici aux arts chinois des laques, des céramiques, des paravents et non pas à leurs déclinaisons occidentales que se réfère Goncourt. En 1898, Champfleury épingle la mode des japonaiseries qu’il interprète comme une dernière veine d’orientalisme : « De même qu’il y a eu en 1820 des avalanches de pifferaro en peinture, des déluges de Grecs et de Turcs en 1828, des Bretons en assez grande quantité vers 1840 pour peupler la Bretagne, […] aujourd’hui nous sommes tous menacés d’une invasion japonaise en peinture. »
Champfleury charge dans le même texte l’orientalisme anecdotique, le mauvais Japon, la « japoniaiserie », qu’il oppose à une inspiration plus sincère du Japon que l’on peut appeler « japonisme ». Il faut toutefois attendre 1912 pour que ce dernier terme apparaisse dans une série d’articles « à la gloire de l’art japonais » écrits par Philippe Burty. L’auteur n’y donne pas de définition claire mais sa réfutation du « japonisme, ce caprice de dilettante blasé… » tient lieu de définition. En revenant sur ce mot, il révèle que du mépris de l’art de l’Extrême-Orient, trop vite assimilé à une japonaiserie par association avec « chinoiserie », découlait en réalité l’incompréhension des œuvres qui s’inspiraient des arts japonais sans imitation ni citation littérale. Des œuvres comme La Promenade des nourrices, frise fiacre de Bonnard ou L’Âtre de Vuillard relèvent en effet moins de la japonerie ou de la japoniaiserie que du japonisme, qui est ce qu’Edmond de Goncourt avait défini comme une « révélation de l’optique ».
 Pierre Bonnard. Promenade des nourrices, frise des fiacres. 1897. Paravent constitué d’une suite de quatre feuilles lithographiées en cinq couleurs. |
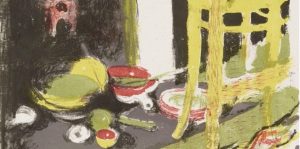 Édouard Vuillard, L’Âtre. 1899). Lithographie, impression en couleurs. |
Sophie Basch et Michael Lucken ont publié un ouvrage sur le sujet aux éditions Hermann.
https://www.editions-hermann.fr/livre/le-neo-japonisme-1945-1975-sophie-basch
Kaltoum LABIB