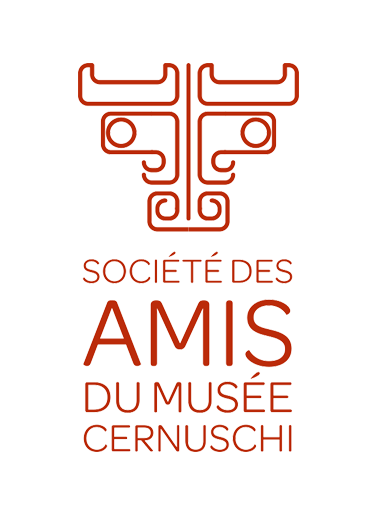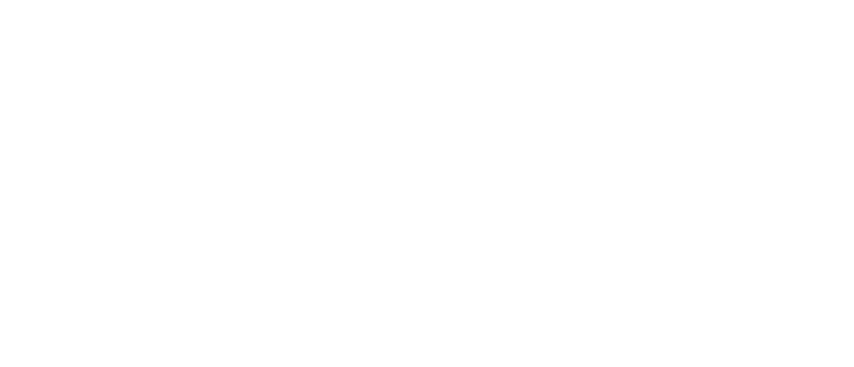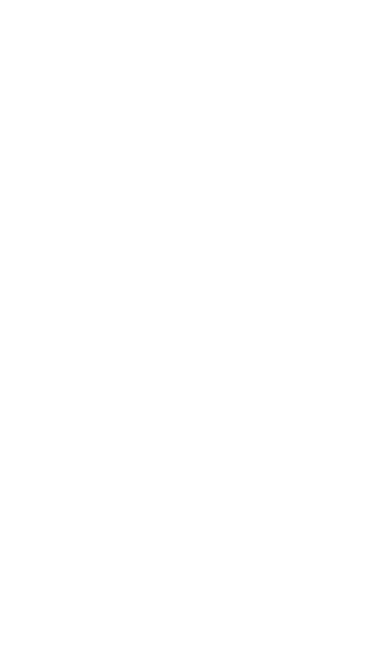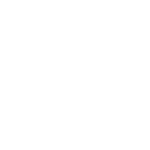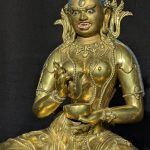Nudité féminine et nihonga (1890-1960) : Le paradoxe d’une certaine identité culturelle
Conférence à 18H00 par Pierre Gautier, responsable des collections japonaises du musée Cernuschi.
Élaboré dans les années 1880 en réaction, entre autres, à la place de plus en plus prégnante de la peinture à l’huile (yōga 洋画) dans l’enseignement artistique, le nihonga (日本画) n’a jamais fait grand mystère de son inclinaison nationaliste et conservatrice. Il s’agit cependant d’un certain faux-semblant, d’un créole comme se plaît à le qualifier l’historien de l’art Furuta Ryō, car, très tôt, nombre de jeunes artistes ont tenté de conjuguer peinture traditionnelle et éléments d’origine occidentale. Dès la mise en place du Salon officiel (bunten 文展) en 1907, de féroces dissentions éclatent entre les tenants d’une plus grande liberté esthétique et une génération plus âgée estimant que cela n’augurerait rien de moins que la décadence de la peinture japonaise. Le rapport au corps, dans sa mise en volume, sa morphologie et ses contrastes – son incarnation, en somme –, fait bien sûr partie des désaccords opposant la vieille garde (kyūha 旧派) et la nouvelle (shinpa 新派). Quant aux sujets abordés, aucune des deux factions ne songe un instant au nu : beaucoup trop occidental ! Et pourtant, durant les années 1900-1910, conscients du succès – voire du succès de scandale – que rencontre le nu féminin dans le yōga au même moment, quelques artistes tentent de concilier nudité et nihonga : d’abord timidement, puis, à partir des années 1920, d’une façon plus flamboyante, sans toutefois que le nu en tant que sujet n’en soit toujours totalement assumé. Généralement prétextée sous couvert de thématiques issues de l’Ukiyo-e ou d’ordre colonial, la nudité féminine connaît, dans les années 1920-40, une diffusion sans précédent dans un courant où on ne l’y attendait pas. Une étude sur le temps long nous invite également à nous questionner sur l’impact socio-politique d’un tel genre. Si le recours à la nudité s’est inscrit dans une ligne aussi étroite que contraignante jusqu’en 1945, l’après-guerre semble en avoir fait un véritable outil de revendication, en particulier auprès des artistes femmes.